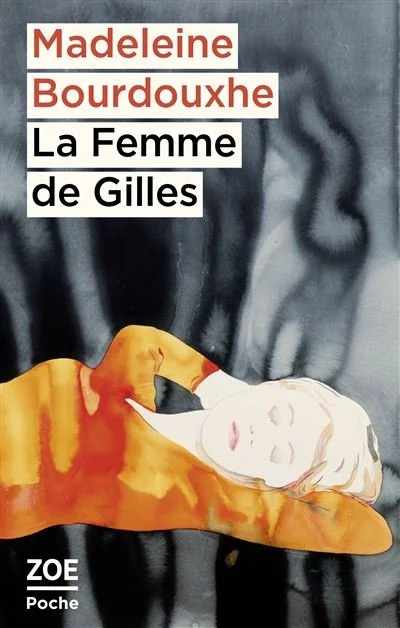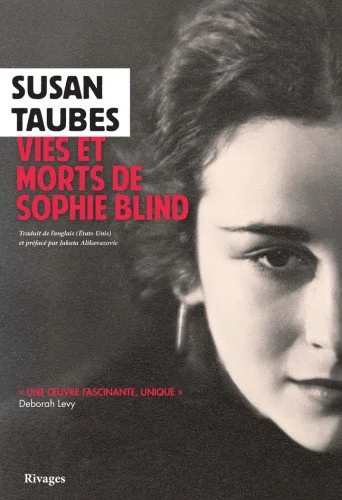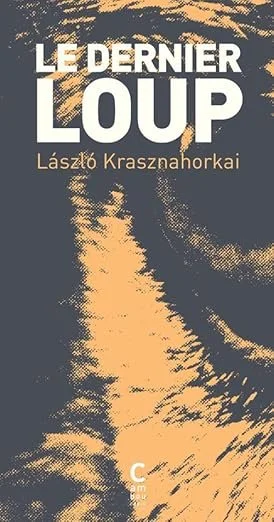Manuela Federico : “Ce qui me semble important, c’est de se construire une identité littéraire.”
Située à Bruxelles, dans la Galerie des Princes, la Librairie Tropismes est sans conteste l’une des plus belles librairies d’Europe. Libraire littérature, Manuela Federico y officie depuis le lancement de la librairie, il y a 41 ans, perpétuant avec attention la philosophie des lieux, faite de curiosité et d’exigence, élaborée par Brigitte de Meeûs et Jacques Bauduin. Rencontre
En 1984 était inaugurée la Librairie Tropismes, aventure à laquelle vous avez participé dès le début. Pouvez-vous nous raconter comment tout cela a commencé ?
C’est un peu par hasard ! À Bruxelles, il y avait une toute petite librairie, située dans la Galerie Bortier, qui s’appelait Macondo. C’est une anecdote assez rigolote. La maman du directeur de cette librairie, Jeanne Bauduin, avait le même coiffeur que ma mère, en province. Elles papotent ; ma mère, étant très fière d’avoir une fille qui étudiait les Lettres, en parle à cette dame qui lui dit : “Ah mais elle doit absolument aller voir mon fils ; il a besoin de quelqu’un.” Je me présente et évidemment, ce n’était pas du tout le cas (rires) ! Puis quelques jours après, il m’appelle parce qu’il recherchait quelqu’un pour assurer l’intendance pour une soirée. Donc je suis arrivée… pour faire la vaisselle. Et je suis restée !
Ensuite Jacques Bauduin a assez vite rencontré Brigitte de Meeûs, à qui il s’est associé pour Tropismes. J’ai passé des mois de ma vie d’étudiante à pointer des catalogues pour ne pas racheter des livres que l’on avait déjà, puisque l’on partait avec le fonds de Macondo.
Tropismes a donc ouvert ses portes dans un cadre superbe, dans la Galerie des Princes, depuis 41 ans….
Par hasard, là aussi ! C’était une opportunité : ils ont trouvé le lieu, qui était complètement abandonné. Maintenant, ces galeries sont un haut lieu de tourisme. Mais dans les années 1980, très peu de gens y passaient. C’était connu des Bruxellois qui y cherchaient le calme et la tranquillité. La café dans lequel nous nous trouvons (Mokafé, ndr) existait déjà, je venais étudier ici. Mais personne n’allait voir cette transversale des Galeries royales Saint-Hubert.
“C’était une opportunité : ils ont trouvé le lieu, qui était complètement abandonné.”
Avant que la librairie ne s’y installe, ça a été beaucoup de choses, ce lieu. Le plus connu, était le Blue Note, un club de jazz, pendant une période de gloire de cet endroit, puis c’est devenu un café, avant d’être abandonné.
Il fallait avoir une certaine dose d’audace pour choisir cet emplacement, malgré toute sa beauté, s’il y avait peu de passage…
Oui ! À l’époque, le premier à réagir a été Henri Causse, ancien directeur commercial des éditions de Minuit. Brigitte de Meeûs et Jacques Bauduin le connaissaient par ailleurs. Il a tout de suite dit qu’il venait ; Brigitte et Jacques lui en ont toujours été reconnaissants. Et ils ont en fait monté un projet ensemble.
Par ailleurs, la librairie Macondo était vraiment la librairie “intellectuelle” de Bruxelles où se rendaient tous les écrivains, comme Jacques Bauduin était très connu dans ce milieu. Il avait également été journaliste et écrivait pour Le Journal des Sciences humaines. Il invitait des gens illustres.
La librairie tient donc son nom du parrainage de Henri Causse, puisque Tropismes de Nathalie Sarraute est publié aux éditions de Minuit ?
Voilà, d’où le nom Tropismes, qui se justifie aussi par ce que l’on voulait y faire. Même si à l’époque, moi j’étais toute petite, donc je n’ai pas défini ce projet avec Brigitte et Jacques ; je l’ai accompagné.
Dans les années 1980, Bruxelles était plus calme, mais il y avait beaucoup de petites librairies spécialisées, par exemple en littérature québécoise, en littérature gay… Beaucoup de bouquinistes aussi et des éditeurs avec des vitrines. Depuis, évidemment, certaines d’entre elles ont fermé.
On fonctionnait beaucoup par groupements. Brigitte de Meeûs tenait fortement à l’interprofessionnalité. Il y avait un groupe d’intérêt commercial qui s’était créé entre les différentes librairies pour faire des achats communs par exemple, pour avoir de moindres coûts. Le groupe avait une camionnette qui circulait vers plus de petits distributeurs en Belgique et qui apportait les colis à chacun. C’était très mutualisé. Je me souviens, au début on recevait toutes les nouveautés pour tout le monde, pour Union Distribution, qui s’appelait Flammarion à l’époque : donc je triais et refaisais des paquets pour ensuite envoyer à chacun.
Ainsi, c’est directement par la pratique que vous avez découvert le monde de la librairie…
À l’époque, il y avait un embryon d’études de métiers du livre. Il y avait quatre ans d’études en Lettres, et ensuite on pouvait accéder à cette formation, que j’ai faite. Mais c’était lunaire ! On avait quelques notions de droit économique et puis aussi des cours de littérature comparée, qui était très peu comparée, puisque ça se limitait à la littérature belge ! Qui n’était par ailleurs pas enseignée à l’université belge…
“Avant, on était moins informés de tout massivement, donc on arrivait à contrôler. Même intellectuellement !”
En 40 ans, quelles sont les évolutions que vous avez pu percevoir dans le métier de libraire ?
Oh la ! Ça n’a plus rien à voir… On peut évidemment parler de la multiplication des nouveautés. C’est vrai qu’auparavant, c’était gérable parce qu’il y en avait moins. Mais aussi on était moins informés de tout massivement, donc on arrivait à contrôler. Même intellectuellement ! Les représentants étaient présents et avaient un vrai rôle d’information. Puisque s’ils n’avaient pas les infos, personne n’en avait ; ça passait beaucoup par eux. À l’époque je ne les rencontrais pas, mais je voyais Brigitte de Meeûs, à longueur de journée, choisir ce qu’elle allait mettre dans sa librairie. C’était avant l’informatisation. Donc on manipulait beaucoup plus l’objet livre en connaissance de cause. On savait qu’on avait un livre en main ; aujourd’hui, parfois on a un objet ou rien en main. Et ça c’est très cruel. On avait aussi beaucoup plus le sens de ses limites.
Dans quel sens ?
On écoutait plus ses doutes et son ignorance. J’entends beaucoup de jeunes libraires : ils ont toujours l’air de parler d’une position de savoir. Je pense qu’elle est parfois justifiée, mais on est quand même aussi intellectuellement des imposteurs, parce qu’on parle de choses qu’on n’a peut-être pas lues en entier, ou dont on ne sait pas d’où elles viennent. Elles proviennent peut-être d’une racine beaucoup plus profonde que l’on ne pense, mais que l’on n’a pas pris le temps de creuser ; donc il manque un élément. Pour beaucoup de choses, on travaille un peu sur pilotis. Et je pense que d’avoir appris à parler sur son ignorance plutôt que sur son savoir, ça aide un peu. À être toujours conscient de ce que l’on ne sait pas. Et aujourd’hui, cette conscience a disparu à cause de l’ordinateur. On peut poser n’importe quelle question à n’importe quel libraire, même un qui commence, il va trouver une réponse sur son ordinateur. En plus, l’intelligence artificielle maintenant vient nous compliquer la vie. Parce que c’est bien gentil tout ça, mais est-ce que ces réponses conviennent vraiment à ce que la personne demande ? À ce dont elle a envie ou dont elle n’aurait pas envie, mais dont on pourrait sentir qu’elle pourrait peut-être avoir envie ?
“Je pense que d’avoir appris à parler sur son ignorance plutôt que sur son savoir, ça aide un peu. À être toujours conscient de ce que l’on ne sait pas.”
Ce sont donc en quelque sorte des possibles qui disparaissent ?
Voilà. Il y a ce qu’on trouve dans le mot Tropismes : tropisme, c’est un déplacement. Et ce déplacement devient actuellement plus compliqué, parce que l’on a des réseaux qui se marquent de plus en plus. Et l’on voit que ça aide à savoir énormément de choses. Il y a des jeunes extrêmement spécialisés dans un domaine : ils savent tout ! C’est même hallucinant. Ils savent qu’untel va publier un collector qui sera de telle et de telle manière. Mais, ça reste un réseau très précis. Et il est très difficile d’en sortir parce que ça nécessite une curiosité presque dangereuse, parce que l’on ne sait pas où l’on va tomber. Et ça prend beaucoup de temps. Quand on fait ce métier, on n’a pas le temps, on n’a plus le temps. On ne va pas assimiler.
Il y a souvent cette conversation qui revient avec les libraires, d’une certaine urgence de lire tel ou tel livre qui va bientôt être publié, pour savoir de quoi il parle et réussir à le conseiller, voire même d’une difficulté à prendre le temps de lire…
Il y a quelque chose d’important chez Tropismes : on ne travaille pas sur la consommation, on travaille sur la multiplicité des libraires. Et c’est pour cela que ça s’appelle Tropismes - Libraires. Il y en a dans l’équipe, qui sont plus ou moins âgés, qui ont cette capacité absolument merveilleuse à une curiosité plus large. J’ai un collègue hallucinant - bon il est insomniaque, ça aide (rires) -, il lit énormément, un peu dans tous les domaines, parce qu’il est très ouvert. C’est d’une générosité monumentale vis-à-vis du livre. Il va trouver quelque chose, le retenir. Et ça, à travers toute sa carrière. J’ai une admiration sans bornes pour ça, parce que c’est quelque chose dont j’ai toujours été incapable.
Avant, je ne choisissais que dans les domaines de la littérature traduite et des arts du spectacle. Depuis le décès de Brigitte de Mêeus, je vois les représentants et choisis tous les livres. Je garde un aspect très technique. Je déballe toutes les nouveautés dans le magasin : c’est très fatiguant, mais il y a des stratégies et ça va beaucoup plus vite qu’avant. Mais je vois absolument tout. Et je place tout dans le domaine de la littérature. C’est-à-dire que chaque livre va avoir la place que je vais lui donner, que je vais changer après, selon. Et ça c’est ce que j’appelle la technique : je vais voir le livre sans le lire, parce qu’il y a des informations. Il y a des niveaux et Brigitte avait mis en place un place un système, que j’ai conservé : tout le monde, en sachant plus ou moins, à quel genre appartient tel livre, en littérature, peut le retrouver.
“Il y a quelque chose d’important chez Tropismes : on ne travaille pas sur la consommation, on travaille sur la multiplicité des libraires.”
John Berger, dans un de ses livres, a mis en exergue une phrase qui dit plus ou moins que “la première chose, c’est l’espace, la deuxième chose, c’est le temps”. Donc, on parle toujours du temps, mais une librairie, c’est avant tout un lieu où les gens vont venir.
Un lieu aussi où le lecteur puisse déambuler pour trouver soit ce qu’il cherchait, soit découvrir autre chose…
Exactement. C’est une maison. Et ça s’oublie, justement à cause des réseaux. Parce que l’on peut très bien montrer un livre sur Instagram qu’on va avoir mis dans un petit coin, parce que de toute façon on pense qu’il ne se vendra pas. Ça, ça ne va pas. C’est-à-dire qu’un livre qu’on sait qu’il se vendra peut-être peu, mais auquel on a envie de donner une place, et bien on lui donne une place, en vrai. C’est-à-dire qu’il va occuper un espace. Et si vous parlez à un Américain, il va vous dire que de l’espace, c’est de l’argent. Et bien la place qui veut dire de l’argent, c’est ce livre-là qui va l’occuper. C’est un risque, mais il faut le courir. Après, il faut évidemment prendre des risques limités. On sait très bien, qu’il y a des emplacements de la librairie qui payent le loyer. Il faut jouer avec toute cette honnêteté, peut-être malhonnête ?
La réalité du fait que la librairie est un commerce ne peut en effet être écartée.
Oui et nous voulons qu’il dure, on ne veut pas qu’il soit en danger, on veut que les gens continuent à s’y sentir bien, que les gens restent. Parce qu’une équipe de libraires qui reste, c’est important.
“Un livre qu’on sait qu’il se vendra peut-être peu, mais auquel on a envie de donner une place, et bien on lui donne une place, en vrai.”
Combien de libraires travaillent à Tropismes ?
On est 15-16, dont plusieurs ne sont pas à temps plein. Mais le revers du fait que tout le monde est resté très longtemps est que tout le monde prend sa retraite en même temps…
Lorsque l’on se promène dans les rayons de de la librairie, on perçoit qu’outre les publications les plus récentes, une place importante est accordée au fonds…
On est une librairie de fonds. Donc on a créé quelque chose de cohérent, une atmosphère, qui entoure les gens. Dans mes périodes parfois un peu grand ponte qui a vécu, je dis que j’ai littéralement passé ma vie dans cette librairie. J’y suis rentrée à 25 ans, maintenant j’en ai 65. Et c’est ce que je souhaite de mieux aux jeunes qui arrivent dans cette librairie : qu’ils puissent passer leur vie dans cet endroit. C’est inimaginable ; quand je m’en vais le soir, je ne peux pas m’empêcher de regarder une dernière fois les rayons. Je les regarde toujours beaucoup d’ailleurs, parce que je fais attention à ce qu’ils soient entretenus. C’est une chose qui est devenue parfaitement ridicule, mais j’ai même trouvé des techniques pour nettoyer les livres quand ils ont pris trop la poussière (rires)…
Mais je me rends compte que c’est un héritage qu’on donne aux gens. Ceux qui ont construit ces rayons sont des gens qui ne sont plus là, pour la plupart. J’ai essayé de les entretenir en y mettant des livres nouveaux, mais c’est une responsabilité. Les éditeurs ne se rendent peut-être pas toujours assez compte que quand ils sortent un ouvrage, on le met sur une table, c’est bien joli. Mais ensuite, en tant que libraire, je vais me poser trois questions : est-ce qu’il va aller au retour ? Est-ce qu’il va aller en poche - ça c’est bien ? Est-ce qu’il va aller dans le rayon des grands formats qu’on va garder ?
Et donc, prendre de l’espace, là aussi…
Prendre cette place ET être regardé par les générations qui vont venir, parce que les tables, ça passe.
“Chez moi, les tables se conçoivent comme des tournesols.”
Parfois assez vite, non ?
Chez nous, ça ne va pas très vite. Mais dans beaucoup de librairies, ça va très vite. Et je vois des techniques de jeunes qui arrivent qui ont appris qu’un livre en remplace un autre. Je leur dis que non. Un livre va en déplacer un autre. Finalement, on ne travaille que par déplacement. Chez moi, les tables se conçoivent comme des tournesols, c’est-à-dire qu’elles se tournent vers le rayon petit à petit. Ainsi, une nouveauté, on va tout d’abord la mettre tout devant. Puis, petit à petit, elle va aller vers le rayon. C’est un cheminement qu’on lui doit. Là, je parle de la littérature, mais pour les sciences humaines et l’histoire, c’est un peu le même principe.
Il y a des livres qu’on peut laisser longtemps sur les tables, jusqu’à ce qu’ile aient trouvé à peu près tout leur public, toute une potentialité qu’il ne faudrait pas gâcher. Et puis je ressors beaucoup de livres sur les tables. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre de vieux livres sur les tables. C’est une option assez luxueuse, et qu’on peut se permettre jusqu’à un certain point. Il y a des choses auxquelles on peut rester attaché et si on ne suit que la rotation, il y a des livres qui vont très vite disparaître. J’ai un sentiment global vis-à-vis des choses : un rayon, si certaines choses n’y sont pas, il va boiter. Parce que ce sera le chaînon manquant.
Je trouve ça intéressant parce qu’il se crée une espèce de bulle autour des nouveautés, donnant l’impression qu’il faudrait les lire là, maintenant, tout de suite, que sinon ce sera trop tard. Or, la lecture est aussi une question de moment et d’envie. Peut-être qu’une rencontre entre un lecteur et un livre ne peut avoir lieu que quatre ans après sa publication…
Et bien ça, c’est le travail du libraire de l’avoir encore ou au moins d’en avoir la mémoire. Ce qui est encore plus important dans le cas de textes qui n’auront pas la chance de sortir en poche. C’est peut-être une habitude de littérature traduite aussi, dont je m’occupais auparavant, parce que les publications sont évidemment toujours décalées. Dans les langues qu’on connaît, on sait ce qui va sortir en français plus ou moins un ou deux ans après.
Ce qui entraînerait ainsi, selon vous, un rapport différent au temps ?
Oui, et c’est vrai que je viens plus de là que de la littérature française. Le rapport au temps est en effet différent. Et puis, on va plus aussi vers des auteurs morts. Parce que c’est encore intéressant de les publier. Alors oui, on ne peut pas l’inviter à un festival ! Mais si on ne connaît pas les auteurs morts, est-ce qu’on va vraiment s’intéresser aux auteurs vivants ?
Parce que les auteurs vivants peuvent aussi s’être appuyés sur les textes de ces auteurs morts, non publiés en français avant. Et un jour, ils seront morts aussi , pouvant être rassurés de savoir que leurs livres seront encore disponibles à la librairie Tropismes !
(Rires) Ce n’est pas très sympa ce qu’on dit, mais c’est aussi très factuel ! C’est comme l’âge. C’est une chose que j’ai expérimentée, car je n’ai pas l’impression d’avoir pris 40 ans comme je suis restée dans mon univers et dans mon ignorance totale, je ne suis jamais arrivée quelque part…
“Je ne lis que ce que je veux lire, ce qui me construit, moi.”
Est-ce que ce n’est pas aussi ce qui continue de créer l’envie et le désir ?
Ce serait peut-être beaucoup de parler de curiosité… Je connais des gens vraiment curieux et c’est autre chose ! Ce sont vraiment des découvreurs… J’ai eu l’occasion de travailler pendant quelques années avec un jeune homme qui est vraiment décédé beaucoup trop tôt. Et lui, c’était la curiosité incarnée, avec un dynamisme, avec une fougue et un éclat, le panache de la curiosité. Ça, c’était une leçon totale. Mais moi, je suis aussi engluée dans les problèmes techniques, je dois être là tous les jours…
Et puis je suis monomaniaque, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc je lis tôt le matin, je lis le soir, mais je ne lis pas pendant la journée. Mais je ne lis que ce que je veux lire, ce qui me construit, moi. Jamais je ne me suis obligée de lire quoi que ce soit. Là encore, c’est la partie technique qui parle. Avec l’expérience, quand je déballe les livres, je mesure assez rapidement ce qui pourrait m’intéresser, même si c’est un peu du philistinisme, mais bon il faut accepter qu’il y a ça. Et puis, il y a les livres qui ont besoin d’un regard qui n’est pas réseauté, venant d’un mélange d’influences un peu bizarres que j’ai pu avoir dans ma vie. Et d’une grande naïveté aussi, car c’est de là que vient l’émerveillement. Et cette naïveté, ça vous garde la jeunesse. Je vois bien qu’il y a des jeunes gens qui n’osent pas me demander conseil, craignant que la vieille aux cheveux gris leur conseille du…
Poussiéreux ?
Oui ! De même qu’il y a des auteurs qu’on ne lit plus parce qu’ils sont âgés. Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de rencontrer quelqu’un comme Richard Ford, par exemple, mais je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi curieux, d’aussi jeune ! Il y a des jeunes qui écrivent le même livre toute leur vie. Et des vieux qui se renouvellent à chaque texte, et à chaque fois, c’est une explosion ! Ils font vraiment éclater leur expérience et remettent tout en question.
Ce qui me semble important, c’est de se construire une identité littéraire. C’est celle-là qui va jouer, qui va permettre un transfert avec certains clients. Et pas avec d’autres. Il y a des clients, je sais que jamais je n’arriverai à leur vendre un livre ! Ou alors ce sera en écoutant les conseils d’un de mes collègues…
D’où l’intérêt d’être plusieurs dans une équipe aussi, afin de pouvoir répondre à la variété des goûts des clients qui passent la porte de la librairie, et création des affinités…
C’est aussi un des avantages de vivre si longtemps avec les mêmes collègues. Je sais, si c’est une une telle qui a rangé le livre qu’elle l’aura mis à tel endroit. Maintenant, avec les libraires arrivés plus récemment, je n’arrive pas encore à me mettre dans leur tête et à forcément retrouver aussi vite ! Même si l’on a des règles et que l’on est structuré, même si ça n’en a pas l’air, quand je raconte les choses comme ça. Transmettre cette structure, je n’ai pas encore trouvé le truc.
Quel est le type de public de la librairie ? A-t-il évolué au cours des quarante années de vie de la librairie ?
Il y a de tout. Au départ, c’était très intellectuel, disons. C’était l’époque où tout Bruxelles déferlait dans le centre le week-end. Les artistes, les professions libérales, les intellectuels de tout genre. Ils venaient de partout parce que le centre ville n’était pas ce qu’il était aujourd’hui, c’était très facile d’accès. Ensuite, il y a toute une diversité de librairies qui se sont ouvertes, et ça c’était bien. Puis ça s’est compliqué depuis une bonne dizaine d’années.
Et puis nous avons vu vieillir nos clients. Et là, même si c’est de loin en loin, c’est une richesse étrange. On les a vu avoir des enfants, des petits-enfants qui vont maintenant à l’université...
C’était une période assez vivante, très occupée, où on se souciait surtout d’avoir les bons livres au bon moment. On surveillait tous les médias. C’était un vrai travail, il n’y avait pas les possibilités actuelles. On devait toujours être un peu à l’avance de ce qui allait se passer.
“Il ne fallait pas décevoir les gens, on se devait d’avoir certains livres parce que c’était notre rôle.”
C’était donc tout à la fois un travail de veille et de flair ?
Maintenant il y a ça aussi, mais un peu moins. C’est devenu une routine. Alors qu’avant, c’était un élan : il ne fallait pas décevoir les gens, on se devait d’avoir certains livres parce que c’était notre rôle.
Ce n’est plus autant le cas maintenant ?
Moins, parce que d’abord les gens ont d’autres canaux d’approvisionnement, ce qui est très bien quand ce sont d’autres librairies. Pour ce qui est d’Amazon et tout ça, c’est un autre problème… Mais on ne peut pas l’empêcher. Et puis le centre est devenu plus compliqué, plus touristique donc on a eu une période qui a été très gaie aussi parce qu’on s’est adapté à une clientèle curieuse d’une autre sorte de livres aussi. Par exemple, on n’avait pas beaucoup de livres pour enfants, on a développé toute cette partie-là, on a même créé un espace uniquement dédié aux livres jeunesse et aux bandes dessinées. Ça ressemblait à un appartement, avec un salon. Ça c’était la grande folie ! C’était en 2008 : ce n’était pas la bonne période, et c’était trop lourd à gérer.
On a eu une période où on disait qu’on avait beaucoup une clientèle âgée, donc il a fallu trouver des trucs pour faire venir des jeunes.
Par quels biais ?
Au départ, on a fait beaucoup avec le rayon de théâtre. C’est un rayon qui est un peu plus oublié maintenant. Mais ça a fait venir des jeunes. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu’il fallait qu’on ait plus de livres en anglais. Donc nous avons développé cet aspect-là. J’ai créé un rayon très particulier, des livres qu’on partage beaucoup avec la librairie Passa Porta, qui est plus anglophone. C’est assez ciblé et ce ne sont pas des livres qu’on trouve dans les grandes librairies anglaises, je m’en contrefiche que ce soit récent ou ancien.
On revient à la question de la création d’un fonds…
Oui, ça correspond à un certain genre d’intérêts. C’est tout petit, mais ça a pris une petite réputation et ça a amené beaucoup de jeunes aussi. Et en fait, depuis le Covid, on se rend compte qu’il y a énormément de jeunes dans la librairie. Au début, ce sont surtout eux qui ont repris à se déplacer et les personnes plus âgées n’osaient pas trop sortir. Et puis on a fait pleins de choses…
On propose beaucoup d’événements. Et c’est très gai ; on y tient. Que ça garde un niveau choisi aussi. On l’a toujours fait, depuis que Tropismes existe. Dès le début, en sociologie, on organisait des événements et il y avait Bourdieu, Sollers. On avait aussi par exemple fait venir Danilo Kis : quand je dis qu’il était venu à la librairie, personne ne me croit (rires), mais il était bien là ! Cees Noteboom est venu plusieurs fois, et c’était une merveille.
Vous mettez joliment en valeur la littérature belge francophone. Quel rôle avez-vous dans sa divulgation ?
Tout au départ, nous n’avions pas de rayon de littérature belge. Parce que tout est classé par langue, donc on s’était dit que la nationalité n’avait pas d’importance. On nous a posé beaucoup de questions sur ce positionnement. On a réalisé qu’il était temps de créer ce rayon spécifique, même si l’on avait déjà tous les livres en rayon. Mais ça s’est fait très vite, peut-être dès notre deuxième année. Dès qu’on a eu la place, en fait ! Parce qu’il faut savoir que quand on a commencé, c’était tout petit. On n’avait que le rez-de-chaussée et la mezzanine, dédiée aux sciences-humaines et aux beaux-arts, des tout petits rayons bande dessinée et jeunesse. Mais on a vite dû s’organiser pour agrandir. Grâce à de la chance, des interventions des éditions de Minuit qui nous ont toujours beaucoup soutenus.
La littérature francophone de Belgique a vraiment pris un essor chez nous aussi parce qu’elle a été tout d’un coup soutenue par une institution qui s’appelait la Promotion des Lettres belges de langue française.
Il y a eu une politique de soutien à cette littérature mise en place, de manière globale ?
Il y a eu une vraie politique de porter cette littérature. Il y a eu les éditions Jacques Antoine qui ont fait des merveilles pour le patrimoine, dont la plupart des titres sont repris maintenant par Espace Nord. Maintenant, c’est une littérature de niche, mais il faut savoir que dans les années 1960-1970, Gallimard en a publié beaucoup, des gens comme Nicole Verschoore, Maud Frère, Françoise Mallet-Joris. C’est tombé dans un oubli total.
“Il y a eu une vraie politique de porter la littérature belge.”
Au départ, on ne savait pas que les gens étaient belges. Jean-Philippe Toussaint, chez Minuit, je ne sais pas si tout le monde sait qu’il est belge. Maintenant, il y a des événements comme Lisez-vous le belge ? Et puis il y a beaucoup de petits éditeurs, de tous les genres ; ce n’est d’ailleurs pas toujours facile à suivre. Pour nous, c’est devenu de plus en plus important parce que quand un touriste veut lire en français, dit qu’il ne lit pas très bien, on va naturellement vers la littérature belge, parce qu’on se dit il est en Belgique, donc il va lire un auteur belge. Et il y en a beaucoup qu’on peut conseiller très facilement : Madeleine Bourdouxhe, par exemple, qui se lit aisément. Et puis il y a des noms qui ont éclos : Caroline Lamarche, Jean-Philippe Toussaint, Pierre Mertens, qui est plus difficile à lire. Sans compter toute la littérature belge néerlandophone. C’est une autre entité, un autre monde, qu’on ne connaît pas assez bien. Qui commence à se mélanger plus. Notamment avec le poète national, désigné chaque année, qui est une fois francophone, une fois néerlandophone.
C’est important aussi de créer de l’unité autour d’une littérature, même si elle se construit autour de deux langues…
Il y a plus de traducteurs aussi, parce que le néerlandais est une langue difficile, littérairement. On y tient à cette littérature, on tient à sa diversité, mais on ne veut pas non plus en faire un ghetto. Il y a assez peu d’aide à l’édition et on a tendance à considérer qu’un éditeur belge ne doit traduire que du belge. C’est étrange. Parce qu’un éditeur belge peut aussi traduire de la littérature étrangère. Mais, pour ça, ils ne sont pas vraiment aidés. Et un éditeur ne veut pas être dans un carcan pour pouvoir jouer son rôle de découvreur. Or, il y a des choses à découvrir partout.
C’est un peu pour ça qu’on fait ce métier aussi : quand on a compris qu’on avait ce potentiel de trouver le bon livre pour la bonne personne, là on peut dire qu’on peut prendre sa retraite !
En tant que lectrice, qu’attendez-vous d’un texte littéraire ?
Ça dépend des périodes. Mais il y a quelque chose qui se rapproche du déplacement… Il faut qu’il y ait quelque chose qui trouble. Des certitudes, par exemple. Je ne lis pas énormément de genres, je ne lis presque pas de livres d’histoire, mais j’aime trouver de l’histoire dans les romans, j’aime trouver de tout dans les romans. Et je lis beaucoup d’essais sur les romans, beaucoup de journaux et de correspondances d’écrivains, tout ce qui ouvre en fait. Mais je quitte rarement ma zone de confort. J’ai du mal avec des textes ouvertement fantastiques. Je ne lis pas vraiment de romans policiers, mais je vais me tourner vers Patricia Highsmith quand j’ai un problème de lecture. C’est un antidote, elle a quelque chose dans ses débuts qui ouvre. J’aime les gens qui ouvrent, j’aime ne pas comprendre au début ou à la fin et me dire que ce n’est pas grave, parce que j’ai trouvé ça merveilleux. Au contraire, je n’aime pas du tout les auteurs qui ferment, donnent l’impression de tout nous expliquer. Et puis savoir que je vais pouvoir en parler à untel qui va certainement le prendre par le bon bout. Quand on arrive à faire ça et que la personne en parle mieux qu’on aurait pu le dire, les avoir mis sur le chemin d’un texte à côté duquel ils auraient pu passer, ça, c’est une grande richesse. C’est un peu pour ça qu’on fait ce métier aussi : quand on a compris qu’on avait ce potentiel de trouver le bon livre pour la bonne personne, là on peut dire qu’on peut prendre sa retraite !
Mais pas tout de suite tout de même… Et dans vos dernières lectures, quels sont les textes vous ayant particulièrement marquée ?
Il y en a un qui reste qui s’appelle La Fractale Baudelaire de Lisa Robertson (aux éditions du Quartanier, ndlr).
Et là, je lis par morceaux les journaux d’Helen Garner. Ce n’est pas traduit, mais ça s’appelle How to end a story : rien que le titre me plaît…
Et aussi Vies et morts de Sophie Blind de Susan Taubes (publié aux éditions Rivages, ndr), traduit par Jakuta Alikavazovic, que je remercie énormément. J’ai essayé de le lire plusieurs fois en anglais, mais il me manquait trop d’éléments. À la rentrée a d’ailleurs été publié le dernier roman de Jakuta Alikavazovic, qui est assez troublant aussi.
Le dernier de Caroline Lamarche, Le Bel Obscur (publié aux éditions du Seuil), aussi est très intéressant.
Quels sont les livres que vous aimez offrir ?
Offrir, c’est comme conseiller : c’est offrir à une personne.
Mais il y a des livres qu’on peut offrir plus facilement. Peut-être un livre qui peut plus généralement être apprécié, c’est Le Dernier Loup de László Krasznahorkai (publié aux éditions Cambourakis, ndr) parce que c’est court, ce qui est bien quand tu ne sais pas si les gens vont aimer. Et puis ça parle de littérature, de nature, d’une forme de violence ancestrale qu’on ne mesure pas toujours. László Krasznahorkai est un auteur parfois trop compliqué pour moi, donc il y en a beaucoup que je n’ai pas finis. Mais ce n’est pas le cas de celui-là.
Informations pratiques :
11, Galerie des Princes
Galeries Royales Saint-Hubert
B-1000 Bruxelles
T. +32 (0)2 512 88 52
F. +32 (0)2 514 48 24
Ouvert tous les jours
Du lundi au vendredi : 10h00 - 18h30
Samedi : 10h30 - 19h00
Dimanche : 13h30 - 18h30