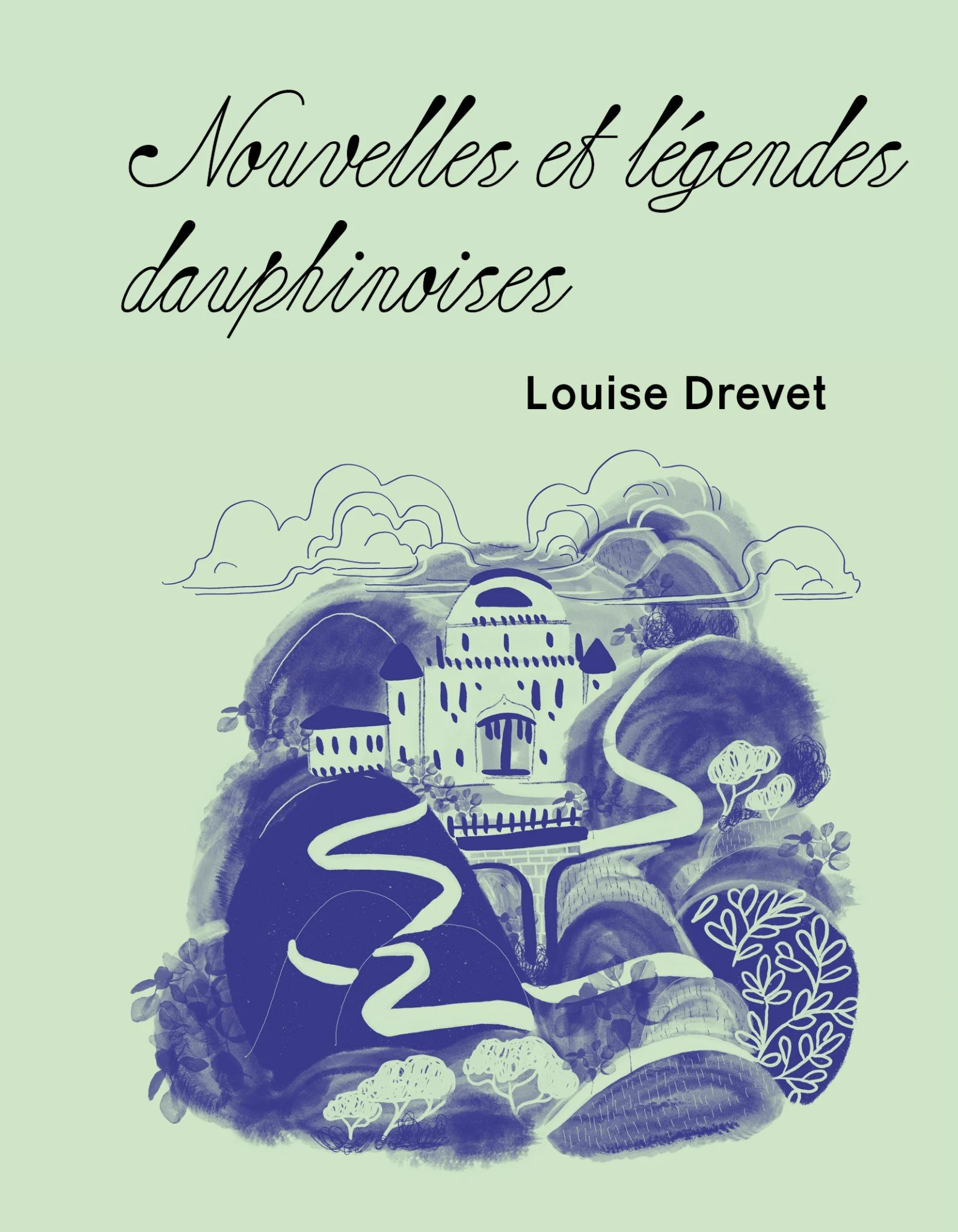Laura Boisset : “Dans le processus de publication d’un livre, j’aime tout, de A à Z.”
Que ce soit à travers des textes originaux ou des rééditions, les Véliplanchistes, maison d’édition associative, se font fort de soutenir des talents naissants ou de remettre en lumière de grandes autrices oubliées du matrimoine francophone. Tout en s’engageant dans une démarche la plus éco-responsable possible. Rencontre avec sa fondatrice
Comment le projet des éditions des Véliplanchistes est-il né ?
C’était un projet de master, qui n’était pas du tout censé durer. D’où le nom un peu particulier. Mais qui attire l’attention, donc je pense que je vais le garder ! J’étais en master Métiers du livre et de l’édition, à Rennes. On avait pour mission de monter des projets. En général, c’était des livres. Mais j’ai plutôt voulu monter une structure.
Avant, j’étais dans la musique, j’avais déjà monté des petites structures, j’avais notamment un webzine que j’animais. D’abord à propos de la musique, puis après des livres aussi. J’ai une formation en Lettres modernes, donc malgré la musique, je voulais faire quelque chose autour du livre. L’idée était toujours tout de même ciblée sur la musique, puisque je voulais créer une maison d’édition qui donnerait la parole aux artistes de la musique. Notre premier projet a été un premier roman, celui du chanteur et guitariste d’un groupe qui s’appelle Metro Verlaine : Ballade sauvage d’Axel Desgrouas. J’étais spécialisée dans la musique underground, c’était très indé, donc très peu connu.
C’est à chaque fois ce qui m’attire justement, d’aller cibler des talents naissants et d’essayer de participer à leur diffusion assez tôt.
Tout a commencé comme ça. Avec une revue aussi, mais que je n’ai pas continuée, parce que j’ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et ce n’est pas ce qui m’a plu le plus. Et en fait, ce livre a été un succès, je l’ai vendu à 150 exemplaires. Pour une structure quasi-inexistante et peu de moyens, je me suis dit que c’était chouette. Et surtout, c’est très addictif de faire des livres, j’avais vraiment envie de continuer et de faire d’autres projets. Ça a mis un peu de temps à germer, et le temps de trouver la confiance pour se lancer ; la maison existe depuis 6 ans, mais est vraiment active depuis 4 ans.
Vous nous racontez l’origine de ce curieux nom que vous avez choisi pour la maison d’édition ?
Je n’avais pas trop d’idées et ne voulais pas non plus aller chercher quelque chose de trop alambiqué, qui risquait de ne plus me plaire assez rapidement. Et surtout j’ai suivi les conseils d’une amie, qui m’a suggéré de choisir le titre d’une chanson que j’aime bien, comme au début ce devait être plus une maison ciblée musique. J’ai choisi une chanson de Flavien Berger, "Les Véliplanchistes". Et j’aimais l’écriture et la prononciation de ce mot long et peu connu.
Après le master et le succès de ce premier projet de publication, quelle direction ont pris Les Véliplanchistes ?
J’ai toujours poursuivi dans la musique, un peu à défaut. Parce que je ne recevais pas trop de manuscrits qui m’intéressaient. Et puis je tâtonnais, c’était le début. Comme après le Master je travaillais pour les éditions Textuel spécialisées dans les beaux livres de photographies, j’avais envie de me lancer dans cette aventure. Alors j’ai fait un beau livre de photographies sur les musiques rock, punk et underground avec Guendalina Flamini, avec qui on écrivait des articles pour le magazine Longueur d’Ondes : j’écrivais et elle prenait des photos. Et pareil, petit succès pour Glassy Eyes : 100 exemplaires sont partis assez vite !
L’envie de poursuivre en plus grand était là. J’ai alors affiné ce que je voulais faire. Pour continuer dans la dynamique texte/images du premier roman publié, qui était agrémenté de photographies prises par l’auteur, j’ai créé la collection Entrelacement. L’idée étant de lier écrit et images, que cela vienne du même artiste/auteur/autrice, ou faire se rencontrer deux univers. Une collection que je poursuis, mais en grand format, pour laisser plus de place aux illustrations ou photographies.
La collection a commencé en petit livre. Mais qui en fait est assez compliqué à faire du point de vue de la fabrication et qui est un gros gaspillage de papier.
Je pensais faire un format A6 simplement découpé, pour moins gaspiller. Mais comme il y a de l’illustration pleine page (au vu du petit format), il faut nécessairement qu’il y ait un bord de 3 mm. J’envisageais aussi la maison d’édition comme un laboratoire d’expérimentation pour moi. J’apprends au fur et à mesure sur la fabrication. Je fais désormais un grand format, un A4 avec vraiment juste le bord qui est découpé pour tout ce qui est les sécurités techniques en termes d’impression pour les images, pour qu’il n’y ait pas de soucis de raccord.
On sent que l’aspect écologique compte beaucoup dans votre démarche…
L’aspect écologique est très important. C’est aussi pour ça que j’aime bien le fait d’avoir fondé une structure associative. Déjà parce que c’est plus simple à gérer, parce que c’est un projet personnel à part, puisque je suis éditrice de métier dans l’universitaire. C’est ce que je fais en loisir, il ne faut pas que ce soit une très lourde charge pour moi. Et surtout que ça reste du plaisir. Il ne faut pas non plus qu’il y ait un enjeu financier ; ça j’y tiens vraiment. D’où la forme associative. Et sans enjeux financiers forts, ça veut dire que je peux faire les projets que j’aime. Et pas vraiment des projets marketing. Sans enjeu financier, je ne surproduis pas, je ne pilonne pas et je minimise comme cela mon impact sur l’environnement. La maison fonctionne uniquement en circuit court, de l’imprimeur à la maison aux librairies ou lecteurs et lectrices qui commandent sur le site des Véliplanchistes. Sans diffuseur, pas d’allers-retours inutiles et polluants, et mon empreinte carbone reste au plus bas. Pour compenser davantage, des dons sont récoltés sur la vente d’ouvrages pour lesquels c’est possible (ceux sans droits d’auteur/autrice par exemple) et sont reversés à des structures que nous aimons bien : Association Francis Hallé pour une forêt primaire, Reforest’Action, Canopée. On essaie plein de petites choses en termes de fabrication et de gestion pour être les plus éco-responsables possible.
Comment fonctionne une maison d’édition associative ? Quelle est la différence avec une maison d’édition-entreprise ?
La différence, c’est qu’en association, on n’est propriétaire de rien. Ça veut dire qu’on est bénévole sur toute la ligne. Rien ne m’appartient, tout appartient à l’association. Et si je veux dissoudre l’association, il y a plusieurs formules, mais celle que j’avais retenue, si ça devait arriver un jour, ce serait de faire un don à une autre association, de toutes les possessions matérielles et immatérielles. Si j’avais monté une société, en tant que personne, j’aurais été propriétaire, les bénéfices me reviendraient, je pourrais vendre ma société et faire des bénéfices.
L’argent que vous récupérez des ventes de livres sert ainsi à financer le projet ?
C’est ça, tout va dans l’association. Avant tout pour financer l’impression, le coût principal, parce que sinon je fais tout moi-même, avec Corentin Breton, que j’avais rencontré en master d’édition. Lui a commencé par une formation plus dans la diffusion et la commercialisation des livres, et il s’occupe de toute cette partie, qui est essentielle. À savoir le référencement auprès des libraires, ce qui est une partie très précieuse parce qu’on est autodiffusés/autodistribués. Et pour boucler la boucle, c’est ce qui me permet d’avoir une structure éco-gérée. Ça limite les transports. Notre circuit court pourrait l’être davantage, si c’était à la demande avec l’imprimeur. Mais c’est un peu compliqué à mettre en place. Et surtout, il y a des frais de port très chers. Donc je préfère réceptionner les ouvrages, puis faire la vente avec l’association directement. Ce qui me permet de faire les frais de port minimum, les fameux 3 euros, qui ont été décrétés il n’y a pas très longtemps. Et en même temps, les frais de port, j’y tiens, parce que c’est ce qui me permet de ne pas faire concurrence aux libraires. Ce qui est important puisque ce ne sont pas les premiers vendeurs de nos ouvrages, mais certains nous font confiance et c’est chouette d’avoir ce petit réseau-là.
Faisant du circuit-court et étant basés tous les deux à Paris, parvenez-vous à vous faire connaître aussi au-delà de la capitale ?
J’ai aussi des attaches en Ardèche, où j’ai un point de vente privilégié (la librairie Point sur la ligne à Largentière nous apprécie beaucoup, et inversement !). Sinon, après c’est de la commande un peu de particulier à particulier, mais ça passe par une librairie, par exemple sur des sites comme placedeslibraires.com ou leslibraires.com. On a également une liste de diffusion auprès de librairies d’un peu partout en France, Belgique, Suisse et Québec.
Chaque parution est présentée via notre newsletter aux libraires, à qui on essaye de proposer des conditions de ventes intéressantes. On fonctionne par paliers : par exemple, pour une commande, c’est 30%, et à partir de trois commandes et plus, on est à 40% de remise.
Ce qui est énorme surtout pour une petite structure, mais ça nous permet d’être attractifs. Notamment parce qu’on fonctionne en achats fermes, pour justement limiter les livraisons dans tous les sens. Et surtout, nous, ça nous facilite la gestion. Une fois que c’est commandé, on n’en parle plus. Mais comme je sais que c’est une contrainte pour les libraires, on essaye d’être vraiment avantageux. Et puis on prend aussi en charge les frais de port. Aux libraires de faire une commande groupée pour bénéficier de notre plus haute remise sans frais de port !
Ensuite la diffusion, ce n’est pas tellement en librairie, parce que c’est un travail un peu trop lourd. Ça va plus passer par des événements ; on essaye d’être présents sur des salons. Depuis deux ans, on est sur les salons de l’autre Livre. Sur ce salon d’ailleurs, j’ai rencontré les éditions du Carnet d’or, qui fonctionnent un peu de la même manière que les éditions des Véliplanchistes. On a alors décidé de monter un collectif ; c’est non-officiel, juste entre nous, pour mutualiser nos ressources et pouvoir participer ensemble à des salons. Ce qui déjà nous permet de partager une table, des moments sympas. Et les frais aussi ! Au lieu d’avoir une table à 200 euros, on peut partager un petit coin pour moitié moins cher. Et comme nous sommes de toutes petites structures, on n’a pas un milliard de livres à proposer sur la table.
L’année prochaine, on va aller aussi en dehors de Paris : il y a un salon du livre à Lyon, le Magnifique livre, réservé aux éditeurs indépendants. On a aussi la piste d’un salon du livre féministe qui aura lieu au Ground Control. Mais c’est bien de faire au moins deux salons par an, pour vider nos stocks avant l’arrivée d’un prochain livre ! Parce que là, le stock, il est chez nous, dans nos petits appartements parisiens, donc ça prend de la place (rires). Et puis on imprime par tranches de 100 ou 200 pour avoir peu de stock et réimprimer au fur et à mesure, plutôt que d’avoir de grandes quantités qu’on n’écoule pas.
Les ventes réalisées sur le site représentent-elles une grosse part de ventes ?
Ça dépend des projets parce que tout ce qui est de la réédition, ça va vraiment être plus des commandes en bibliothèques passées par des librairies. Ceux avec un auteur vivant, les textes originaux, ça va être au moins une bonne partie sur le site. Sinon, c’est très variable. Pour les ventes 2023, cela représente un tiers de vente en librairies, un tiers sur notre site et un tiers en vente directe, sur les salons.
Parmi les proposition de votre catalogue, on trouve les rééditions d’autrices oubliées de la littérature francophone…
Les rééditions me sont vraiment très chères. J’ai en effet voulu cibler sur la redécouverte du matrimoine littéraire francophone.
L’idée est d’aller chercher des livres qui ne sont plus disponibles et des autrices oubliées et méconnues.
Quand on fait un peu de recherches, on se rend compte que c’est étrange qu’elles soient oubliées, parce qu’à leur époque, c’étaient vraiment des incontournables : des grandes salonnières, des autrices lues même à l’étranger. En plus, nous proposons une préface ou un dossier critique réalisé par une universitaire, pour faire redécouvrir le texte et l’autrice du grand public, mais aussi dans les cercles de la recherche, afin de motiver la recherche sur des autrices.
Notre nouveauté, c’est Nouvelles et légendes dauphinoises de Louise Drevet. Aucune recherche n’a été faite sur elle. Je suis alors vraiment très fière de publier un ouvrage, qui pose un peu les premières bases de la recherche sur cette autrice. J’espère que cela motivera d’autres maisons d’édition et d’autres chercheurs et chercheuses à dépoussiérer les archives et remettre en avant cette femme de lettres si prolifique et passionnante !
Comment les découvrez-vous ? Par vos recherches, des suggestions de personnes, des discussions avec des universitaires ?
Il y a mes lectures personnelles, beaucoup de fouilles sur Gallica, sur le catalogue de la BnF. Et ce sont surtout des femmes de lettres que j’ai découvertes en lisant des ouvrages universitaires, ciblés sur la thématique littérature et genre. Il y a notamment deux ouvrages que j’aime beaucoup : La petite sœur de Balzac de Christine Planté (publié aux Presses universitaires de Lyon, ndr), qui revient sur un problème de société. À savoir que les femmes s’empêchaient elles-mêmes d’écrire, parce que dans la société, ça ne se faisait pas. Ainsi, la petite sœur de Balzac déclarait qu’être écrivaine n’était pas le rôle d’une femme, mais elle écrivait beaucoup, notamment des lettres, parce qu’elle adorait ça. Quelle contradiction entre je ne veux pas faire ce que la société m’interdit, quand moi j’adore ça et trouve un moyen de détourner l’interdit, tout en l’acceptant... quelle torture psychologique ! Et elle est tout de même femme de lettres, parce qu’elle a laissé beaucoup de correspondance.
Et c’est le cas d’un grand nombre d’entre elles, qui deviennent femmes de lettres par cette voix, par le biais de leurs correspondances.
Il y a aussi chez Honoré Champion Les femmes dans la critique et l’histoire littéraire, dirigé par Martine Read, une des grandes figures de ces universitaires qui ont travaillé sur l’invisibilité des femmes de lettres et qui ont cherché à comprendre pourquoi elles ont été invisibilisées. C’est fou de savoir qu’il y a le travail des hommes, mais aussi ce que les femmes s’interdisent. Et aussi les différences de caractère : par exemple, Judith Gautier restait enfermée chez elle et ne travaillait pas à sa légende. Alors que les hommes ont vraiment tendance à travailler leur légende, à se montrer, se raconter, prendre la parole en public. Les femmes restaient peut-être un peu plus cachée dans les salons et elles avaient moins cette faculté à se montrer, à part Colette qui est une des rares à s’être inscrite dans l’histoire littéraire. Les autres restaient cachées dans l’ombre.
J’avais commencé par une collection qui s’appelait "Les Érotismes" et finalement, la réédition de femmes de lettres a commencé comme ça. Avec Renée Dunan La Culotte en jersey de soie, qui était catégorisé comme livre érotique. Et quand on le lit, on se demande vraiment pourquoi ! Je suis partie de cette surprise sur la catégorisation, mais aussi en découvrant l’étendue des romans qu’a écrits Renée Dunan, en me demandant mais pourquoi je n’en avais jamais entendu parler tout au long de mes études de Lettres. Autour de moi, personne ne la connaissait. Et c’est le cas de la plupart des autrices, même dans le milieu universitaire, ce sont des découvertes, c’est assez incroyable. Ce n’est pas un problème de qualité mais de société.
Concernant les textes originaux, comment choisissez-vous les projets sur lesquels vous allez travailler ? Quels sont vos principaux critères ?
Ce sont des coups de cœur ; je reçois environ 10 manuscrits par semaine. Au début, je prenais le temps de répondre à tout le monde, mais là je ne peux plus, je vis avec cette gêne vis-à-vis des personnes qui me confient leurs écrits, mais c’est trop de travail. Et ça va assez vite : aux premières lignes, je sais si l’ouvrage va me plaire ou pas, si je vais vouloir travailler sur le texte ou non. Pour m’aider à prendre les décisions, j’ai constitué un comité éditorial : ce sont des personnes que j’ai rencontrées principalement pendant mes études de lettres ou de métiers du livre et de l’édition. Je leur envoie les manuscrits que j’ai déjà pré-sélectionnés pour avoir leur retour.
Il y a des textes qui n’ont pas besoin d’être retravaillés, en dehors de quelques petites retouches par-ci par-là, et d’autres qui ont plus besoin, où je sens que l’autrice ou l’auteur a aussi ce besoin de travailler le texte avec moi. Par exemple, le dernier qui est paru : Juste après le déluge de feu de Lucie Kervern. Elle m’avait envoyé une nouvelle. Et je me suis dit qu’elle avait tous les univers posés, que tout était là et qu’il ne manquait plus qu’à le développer. On a travaillé sur comment transformer sa nouvelle en court roman.
Il n’y a pas de ligne éditoriale à proprement parler. Sauf pour la collection Entrelacement, qui est de trouver avec l’autrice un illustrateur/une illustratrice ou un/une photographe.
Qu’est-ce qui peut déclencher ce coup de cœur ?
Je cherche un propos dans le roman. Je n’aime pas trop l’autofiction, que je trouve un peu facile. Et ce que j’aime dans le roman, c’est justement l’imaginaire et le fictif. Ce qui est déjà un travail dur, qui n’est pas donné à tout le monde. Et qui permet aussi de sortir plus facilement de la réalité.
Pour moi, un texte ça demande du travail, de la réécriture, et une capacité à l’imaginaire, à ne pas simplement se projeter, soi et sa vie, dans l’écriture.
Partir éventuellement d’un fait réel, mais de le tirer ailleurs. C’est vraiment ce qui va m’intéresser, d’aller chercher plus loin que ce qui se propose à nous instantanément.
Au-delà du propos, ce sont des sujets importants aussi, d’avoir des auteurs et autrices qui vont oser parler de sujets forts. Par exemple, Juste après le déluge de feu, il est fort, il peut éventuellement choquer. Mais c’est important - un peu comme pour le matrimoine littéraire - de donner la parole et d’oser dire. Sans pour autant nécessairement dénoncer. Cela demande du courage d’oser dire et j’ai envie de valoriser cela.
Je vais aussi être très exigeante sur l’écriture, il est important d’avoir des structures de phrases variées, pas de répétitions. Un texte qui a été travaillé, relu, réécrit encore et encore. Et ça, ça se sent tout de suite, je trouve. Dès les premières lignes, ce sera plus l’écriture qui pourrait être un frein.
Si l’on observe vos publications, on perçoit que vous publiez principalement des femmes…
Oui, principalement des femmes, et même pour les universitaires. C’est un peu lié au hasard. Je n’ai pas ciblé principalement homme ou femme, sauf pour la série matrimoine. Mais ce qui est étonnant, c’est que pour cette série justement, dont j’ai publié six titres, c’est que je reçois plus de retours positifs de chercheuses que de chercheurs. J’ai reçu pas mal de refus des chercheurs, alors que les chercheuses, elles répondent avec enthousiasme instantanément. Plus ça va, et plus je m’entoure de femmes ! Donc je tente de contrebalancer en allant chercher des illustrateurs hommes par exemple, pour favoriser une mixité. Mais tout ça, c’est le hasard, ce n’est pas quelque chose de voulu par la maison.
Quel est votre rythme de publication ?
J’essaye de publier deux ou trois ouvrages par an, l’idée étant de ne pas surproduire et de pouvoir vraiment prendre le temps de travailler sur les textes, les vendre. J’ai toujours la peur que les auteurs et autrices soient frustrés du nombre de ventes. C’est certain que ce n’est pas comme une grande maison d’édition, où la moyenne est à 5.000 exemplaires. Les Véliplanchistes, c’est vraiment du tout petit. On prend le temps de travailler sur chaque ouvrage en termes de communication et de diffusion.
Dans ce travail, quelle est la phase que vous préférez ?
Franchement, tout, de A à Z. Même la maquette, j’adore faire ça. Peut-être juste les relectures, quand ça fait quatre ou cinq fois qu’on a lu le même texte, ça devient un peu lassant. Mais c’est important, parce que ça permet de pouvoir passer à la maquette sur un texte où il n’y a plus vraiment de corrections à faire. La partie commercialisation, qui est de remplir des matrices pour un meilleur référencement, ce n’est pas fascinant, mais j’ai la chance que ce ne soit pas à moi de le faire ! Et puis c’est une étape très importante pour que le livre soit visible et facilement accessible, y compris par les libraires et les bibliothécaires. Mais sinon, tout me plait, même les contrats, j’aime bien faire ça. Je les relis, vois à chaque fois ce que je peux changer comme petits détails. Je ne sais pas s’ils sont lus, mais je l’espère, parce que c’est très important : ils indiquent les obligations de l’auteur, mais aussi celles de l’éditeur. J’ai cette obligation de faire paraître un livre dans un délai précis, de le vendre, etc.
Vous avez un travail à temps plein par ailleurs. Comment parvenez-vous à gérer cette activité éditoriale en parallèle ?
En fait, ça va ! C’est du boulot, mais pas tant que ça. Et comme ça reste de l’ordre de la passion, c’est un loisir, pas du travail. Si ça le devenait, je reconsidérerais les choses. Ça doit me demander entre 5 et 10h en plus par semaine. Et l’été en général, je souffle un peu. Ce ne sont que trois livres, ce n’est pas énorme.
Le rythme de publication permet sans doute de pouvoir trouver un certain équilibre…
Oui et surtout, comme je fais tout moi-même, ça va vite, il n’y a pas d’attente entre deux échanges. Sauf pour les manuscrits que je commande, comme les préfaces par exemple. J’ai toujours hâte de lire ce qu’on va m’envoyer ! Mais seule, c’est plus simple à gérer. Il n’y a pas, par exemple, de correction sur PDF, de report, d’aller-retour avec un maquettiste, etc., je corrige tout en direct. Ça va plus vite qu’un travail dans une maison d’édition classique où les délais sont plus longs.
Je pense que je peux faire un livre en deux semaines, sans problème, une fois que j’ai un texte corrigé, ce qui est la partie un peu plus longue.
Pour les rééditions, je trouve des textes sur Gallica, qui ont été océrisés. Là, un travail de relecture est nécessaire, parce qu’il y a plein de coquilles avec l’océrisation, du fait des taches sur les manuscrits ou des lettres qui ont été comprises pour d’autre. Un gros travail de relecture et de vérification, avec le manuscrit original pour comparer. Soit le texte a été océrisé et je peux directement le prendre sur Gallica, soit si c’est des petits textes, comme Nouvelles et légendes dauphinoises, j’ai le texte original et je vais faire le travail de tout recopier, comme les moines copistes !
En tant que lectrice, qu’attendez-vous d’un texte ?
C’est l’écriture, toujours. En général, avant d’acheter un livre, je lis la première page pour voir si ça me convient ou non. Sinon, j’essaye de varier mes lectures, les époques. Je me suis rendu compte que je lisais toujours un peu la même chose. Là je viens de terminer un livre de Chantal Thomas, Le Testament d’Olympe : c’est vraiment le 18e siècle dans tout ce qu’on ne veut pas savoir et tout ce qu’on ne nous dit pas. J’ai adoré. Le 18e, je connais très peu, j’ai aimé lire un texte sur cette époque, qui fait des piqûres de rappel sur l’Histoire.
Et j’essaye de lire un peu de littérature étrangère. J’aime bien varier entre français et anglais, pour ne pas lire les mêmes choses. Ces derniers temps, j’avais l’impression de lire des textes très franco-centrés, très parisiens. Je voulais aller chercher un peu ailleurs. Là je suis en train de lire Nadine Gordimer, une autrice d’Afrique du Sud. Ça se passe durant l’Apartheid, dans les années 1960.
J’aime aussi lire un peu de science-fiction, parce que je connais très peu, donc ça me permet à chaque fois de changer radicalement d’univers. Ce qui permet de redynamiser l’expérience de lecture.
En plus de l’écriture, j’attache une grande importance à la crédibilité des personnages, leur psychologie. Par exemple, j’avais lu un texte de Ruffin dont le sujet était vraiment très intéressant, puisque ça se passe à un check point, un genre de territoire que je ne connaissais pas. Mais j’avais trouvé les personnages terriblement creux, surtout les personnages de femmes. Ce qui fait que pour moi ce n’est pas un bon livre, parce qu’il y a vraiment ce manque.
Ce sont principalement ces éléments qui vont guider mes lectures. Et puis il faut faire confiance aux autres aussi. J’ai une amie qui a une toute petite bibliothèque et qui donne régulièrement des livres à ses amis, ce qui m’a permis de faire de belles découvertes. Les salons aussi sont de bons endroits pour connaître de nouvelles maisons d’édition. C’est comme ça que j’ai découvert les éditions de la Baconnière, ils sont suisses, et j’ai lu un très bon roman d’eux, Inflorescence (de Raluca Antonescu, ndr).
Parmi les derniers textes que vous avez lus, quels sont ceux qui ont le plus retenu votre attention ?
Alors, le texte de Chantal Thomas dont je parlais plus tôt.
Et j’aime beaucoup P.O.L. Et parmi ceux que j’ai lus, j’ai beaucoup aimé Hors gel, d’Emmanuelle Salasc. Un gros pavé entre la dystopie et l’utopie, selon la personne qui lit, ce qui est très intéressant en soi. C’est le mieux de ce qu’on pourrait espérer pour la planète et en même temps les revers. C’est un roman sur l’après, sur des écologistes qui sont au pouvoir et vont mener plein de mesures pour sauver la planète. Et en même temps, il y a une histoire un peu plus personnelle sur la famille, les conflits. C’est un roman comme on les aime, avec une macro et une micro-histoire.
J’aime aussi les textes d’Alain Guiraudie. Ce sont des lectures pour un public très averti, avec des scènes très choquantes, mais il ose. C’est courageux de la part d’un auteur d’écrire des scènes aussi dures et violentes, mais que ça fasse sens, que ce ne soit pas gratuit, qu’il y ait un propos. Et cet auteur est très fort pour ça, et surtout pour montrer des personnages atypiques, que ce soit par leur laideur, leur physique disproportionné, leur vieillesse… Je trouve ça vraiment courageux et plaisant. Lui aussi donne la voix à des personnes qui restent en général dans l’ombre.
Quel texte avez-vous régulièrement offert ?
Vie et œuvre d’Albert Mur, un des premiers ouvrages que j’ai publiés et que j’adore. J’ai du mal à le vendre, parce que c’est un petit ouvrage. Peut-être que dire que c’est un texte de linguistique n’aide pas. C’est d’ailleurs plus sur le geste d’écriture. Et je donne ce texte parce que j’ai envie que l’auteur, Bruno Avitabile, soit connu. Le texte et les images de David Demanet concordent à merveille !